La dépression post-natale des pères : un enjeu trop souvent minimisé
- peterpanvoyance
- 24 nov. 2025
- 5 min de lecture

Introduction
Quand on parle de dépression post-natale, on pense d’abord aux mères — et à juste titre : elles subissent des bouleversements physiques et émotionnels immenses après l’accouchement. Pourtant, les pères aussi peuvent tomber en dépression. Et cette souffrance paternelle, longtemps invisible, a un impact profond sur la famille. Aujourd’hui, il est essentiel de reconnaître que la dépression post-natale des pères n’est pas un phénomène marginal : elle touche plusieurs pour cent des hommes, dans des situations variées, et mérite une attention médicale et sociale.
1. Une réalité chiffrée : combien de pères sont concernés ?
Les études récentes montrent que 5 à 12 % des pères souffrent d’une forme de dépression périnatale — un chiffre qui peut monter dans certains contextes (naissance prématurée, difficultés financières, isolement, antécédents psychiatriques).Dans certaines études encore plus ciblées, notamment quand la mère traverse elle-même une période dépressive, ce taux peut dépasser 15 %. Ces chiffres proviennent d’analyses internationales menées entre 2023 et 2024 et reflètent la variabilité selon les pays, les populations et les méthodes de dépistage.
En France, le repérage paternal se renforce : depuis quelques années, les entretiens postnataux sont de plus en plus préconisés pour évaluer non seulement la mère mais aussi le partenaire. Toutefois, les études françaises montrent que les pères restent sous-diagnostiqués, en partie par manque d’outils spécifiquement validés.
2. Présenter la dépression chez les pères : les différences avec les mères
a) Des symptômes qui peuvent surprendre
Si la tristesse, la fatigue, le désintérêt sont des signes classiques, chez certains pères, la dépression se manifeste autrement : irritabilité, colère, sentiment d’impuissance, repli relationnel, voire comportements à risque (alcool, tabac, isolement). Ces formes « atypiques » rendent souvent le diagnostic plus difficile, car elles ne correspondent pas forcément à l’image stéréotypée de la dépression maternelle.
b) Une temporalité différente
Le début des symptômes peut varier : chez certains hommes, des signe de détresse apparaissent dès la grossesse de la partenaire (on parle alors de dépression prénatale paternelle), chez d’autres, c’est au cours des mois qui suivent la naissance que surgissent les difficultés. Cette variabilité complique le repérage systématique.De plus, la dépression paternelle est fréquemment associée à celle de la mère. Quand les deux parents sont en souffrance, les répercussions familiales – sur le couple, sur l’attachement – sont plus importantes.
3. Pourquoi les pères sont-ils si peu repérés ? Les freins des professionnels
a) Des outils de dépistage pas toujours adaptés
L’un des grands défis : les outils existants ne sont pas toujours conçus pour les pères. L’EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale), très utilisée en périnatalité, a été développée à l’origine pour les mères. Bien qu’il existe des études sur son usage chez les hommes, les seuils de “positivité” peuvent varier et des validations plus poussées sont nécessaires, notamment dans des contextes francophones.
b) Une formation insuffisante
Les professionnels de la périnatalité — sages-femmes, médecins généralistes, PMI, pédiatres — ont souvent moins l’habitude de questionner le père sur son état émotionnel. Leurs formations initiales centrent souvent le repérage autour de la mère. Pourtant, sans un regard explicitement porté sur l’homme, les signes de détresse risquent d’être négligés.
c) Les normes sociales et la stigmatisation
La stigmatisation joue un rôle majeur. Beaucoup d’hommes ressentent qu’admettre une souffrance psychique revient à violer les « codes » de la masculinité : être faible, demander de l’aide, c’est tabou. Le rôle traditionnel du père comme pourvoyeur peut aussi rendre difficile l’expression de la vulnérabilité. Certains craignent de ne pas être pris au sérieux, ou de se plaindre « pour rien » face aux professionnels centrés sur la mère-bébé.
4. Impacts sur la famille : au-delà du père seul
La dépression post-natale paternelle ne touche pas que le père. Ses répercussions peuvent :
fragiliser la relation de couple, en augmentant les tensions, la distance émotionnelle, les conflits ;
perturber la relation père-enfant, notamment via un repli, une moins grande disponibilité, ou des réponses moins sensibles aux besoins affectifs du nourrisson ;
avoir des effets durables sur le développement de l’enfant, notamment sur son attachement, son bien-être émotionnel et même sa santé à long terme, selon des études longitudinales.
Ainsi, repérer et traiter la DPN chez les pères, c’est protéger toute la structure familiale.
5. Regard international : ce que les autres pays font (et ce dont on peut s’inspirer)
Dans plusieurs pays anglo-saxons et scandinaves, les systèmes de santé et de périnatalité ont déjà intégré, depuis quelques années, des modules dédiés aux pères :
des programmes de soutien parental anticipent l’implication des deux parents,
des consultations postnatales formelles invitent le partenaire masculin,
les équipes de professionnels reçoivent des formations sur la périnatalité inclusive.
Dans d’autres régions du monde, notamment dans les pays à faibles ressources, les pères restent souvent invisibilisés. Pourtant, des études dans ces contextes montrent des taux de symptômes dépressifs paternels comparables à ceux observés dans les pays riches, et soulignent l’importance d’adapter les outils et les interventions à la réalité socio-culturelle locale.
6. Vers des solutions : comment améliorer le repérage et la prise en charge
Pour les professionnels de santé :
Intégrer systématiquement le père dans les entretiens prénatals et postnatals : même quelques questions ouvertes peuvent révéler une souffrance.
Utiliser des outils de dépistage adaptés ou en cours de validation : par exemple, des versions de l’EPDS calibrées pour les hommes, ou des questionnaires alternatifs (PHQ-9, etc.), tout en restant attentif aux signes non traditionnels.
Former les équipes (sages-femmes, PMI, pédiatres, médecins) à reconnaître les symptômes paternels, à adopter une posture non stigmatisante et à encourager la prise de parole.
Mettre en place des parcours de soutien conjoints : proposer des consultations dédiées aux pères, des groupes de parole, des ateliers parentaux mixtes (pères/mères).
Pour les familles :
Encouragez les dialogues ouverts au sein du couple : valoriser l’écoute mutuelle, partager ses ressentis sans jugements.
Si le père se sent en difficulté, ne pas hésiter à demander de l’aide : médecin, psychologue, groupe de soutien, même si cela peut sembler “excès de prudence”.
Si la mère traverse une dépression postnatale, penser à faire évaluer aussi le père : la co-détresse parentale est fréquente et nécessite souvent une prise en charge conjointe.
Conclusion : créer une périnatalité vraiment inclusive
La dépression post-natale des pères n’est plus une “phobie” de niche : c’est un enjeu de santé publique majeur. En reconnaissant la réalité de cette souffrance, en adaptant nos outils, en formant les professionnels et en déconstruisant les stéréotypes, nous pouvons offrir un soutien réel et juste aux familles. Quand le père va bien, l’enfant et le couple ont des chances bien meilleures de s’épanouir — et c’est toute la dynamique familiale qui s’en trouve renforcée. Il est temps d’offrir aux pères la place qu’ils méritent dans le suivi périnatal : pas seulement en tant que soutien, mais comme sujet de soin à part entière.
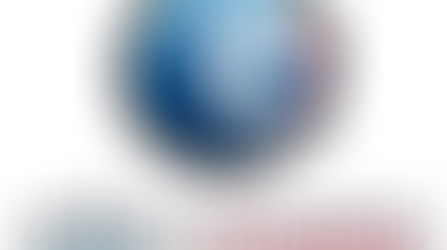




























Commentaires